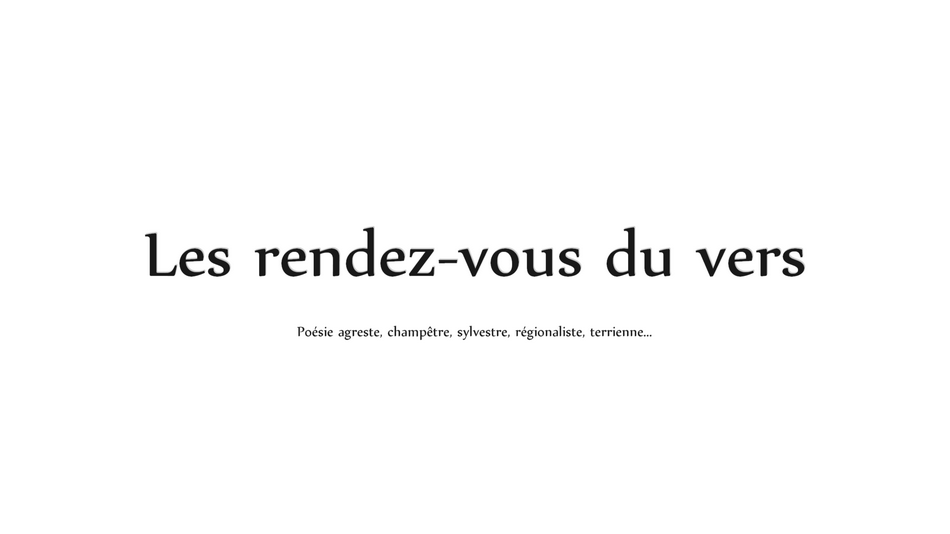Puisque le poète Édouard Michaud (1876-1935) est dans un oubli tel qu’aucune page internet n’en a dressé le portrait (encor moins une page Wikipedia), je le présente ici.
Ses poésies seront à terme probablement les plus fréquentes, avec celles de Marie Dauguet et les miennes, sur Les rendez-vous du vers.
C’est par sa poésie, justement, que je commencerai ledit portrait.
L’on pourrait qualifier celle-ci de « hachurée » si l’on voulait l’imager. Ce n’est pas dans la coulée mais dans le sens aigu de la saccade que ses émotions sont prégnées. Bien sûr, l’on peut voir dans la poésie de cette nature la marque des temps modernes, puisque notre ami Michaud est né en 1876 et décédé en 1935. Mais toujours il a été fidèle, hormis dans son ouvrage posthume, au vers régulier, le seul véritable.
Édouard Michaud, vers 1905, photographie utilisée pour présenter l’auteur lors d’une représentation de sa pièce La Passion.
En fait, il apparaît que cette sensation de « coupures », de « cahots », d’ « entrechocs » procède profondément de la rusticité d’esprit de l’auteur, et pas vraiment d’autre chose. Comment ne pas entendre aux détours de ses vers le choc du métal sur l’enclume, la faulx qui bat les blés jusqu’à brutalement s’arrêter pour le repos du batteur, ou encor l’arrêt des pas du bœuf en plein ahan malgré l’aiguillon qu’on active ?
À cette tendance à la « saccade » s’ajoute une belle maîtrise de la reprise ; reprises n’étant pas forcément illustrées par la terminaison d'une phrase placée à l’hémistiche, mais par l’impression d’un souffle renouvelé sans cesse en plein vers.
Enfin, parmi les spécificités du « style Michaud », notons l’absence de retenue, et donc sa volonté pour la répétition de mêmes mots au sein d’un vers, ce dont il est ordinairement plus élégant de se garder de faire.
L'on retrouve notamment ce type de vers — liste non exhaustive — dans le poème intitulé Là-bas :
Mais les seuils sont peuplés. On cause. Le jour fut
Dur à tous et l’on vient distraire un peu sa peine ;
Et l’on dit, à propos de la moisson prochaine —
Le gai ménétrier qu’on assied sur un fût,
Les ripailles après le travail des faucilles,
— Et l’on entend friser, cristal pur dans l’air pur,
D’un groupe qui décroît, de plus en plus obscur,
Le rire souple et musical des jeunes filles.
Ou aussi dans le poème Le drac :
Vous aviez aux rosiers qui bordent le jardin
Mis des tuteurs liés d’une branche de vime
Ou tenté, délicat, quelque greffe — à la cîme
D’un églantier choisi parmi vingt églantiers ;
Ou encor dans un poème intitulé Panche :
La lune au ciel mettait son arc de toile blanche,
Un ru hâtif sonnait contre des rocs, là-bas,
Et comme se parlant à soi-même tout bas,
Quelque crapaud perdu dans l’ombre où le vent flotte
Tirait de son flûteau toujours la même note,
Et l’on eût dit des gouttes d’eau tombant dans l’eau.
À cela s’ajoutent des petites coquilles, des semblants d’imperfections traduits par les notes de rectifications d’un numéro de revue à l’autre sur tel ou tel poème publié dans ces revues, et qui amplifient l’authenticité de l’auteur. Ces « failles qui révèlent le vivant », si je puis dire.
Dans une chronique de l'ouvrage posthume Du soleil dans la brume, Gabriel Chadelas, de la revue La vie limousine, va plus loin :
« La syntaxe peut paraître incorrecte, l’assemblage des mots se réalise simplement comme les hommes frustes qui vivent autour des objets rustiques ont l’habitude de le réaliser, avec un langage synthétique, sobre de détails et plus près de l’action que du rêve. »
S’ajoutent enfin des tournures de vers que je qualifierais très simplement de circonlocutives. Édouard Michaud semble enrouler ses vers dans des sortes de draps se terminant tantôt sur un léger chiffonnage, tantôt sur une lisseur de soie.
Un critique lui reprochera, avec tort et raison à la fois, de trop en faire avec ces circonlocutions, dans le seul but que son vers échappe à la banalité.
Édouard Michaud, dans sa trentaine.
Ce qui est certain est que ce vers se reconnaît entre tous, signe d’une singularité prégnante. Et, sans doute, ce dont il s’est fait le maître le meilleur est la savante alternance entre vers coulants et vers piqués. Il use à plein de « tuc » (côteau, en limousin), de « choc », de « cep », de « cristal », pour faire son vers plus sec qu’un croûton de pain rassis puis détendre sa poésie avec d’autres vers étendant tous leurs membres, comme on transforme ce même pain rassis en pain perdu. Figure de style commune en poésie, en tout cas chez ceux qui la maîtrisent le mieux, mais qui semble chez Michaud être une seconde nature ; et, mêlée à la sainteté des thèmes de son pays natal, en ressort dans l’excellence.
Jamais sans doute un poète n’eut senti si fort l’odeur du pied de pomme de terre que l’on arrache de celle-ci ; bien qu’en Limousin, c’est la culture de la châtaigne qui règne en maîtresse.
Voyez ces deux premiers quatrains de son poème intitulé Conseil et qui montrent si bien sa « patte » :
Dans une usine aux bruits sans nombre,
Grincements durs et chocs de fer,
J’ai vu, l’œil terne — c’est d’hier —
Profil douloureux touché d’ombre,
Un ouvrier fleurant encor
La lande exquise où le vent passe
Et qui s’en vint troquer, rapace,
Sa liberté contre un peu d’or.
La contrepartie de sa singularité poétique est que sa poésie n'est guère encline à être par cœur apprise, selon moi. Elle ne semble pas viser la « coulée », rentre difficilement d’un bloc dans la tête. C’est en tout cas comment je la perçois : une poésie dont les vers frappent l’esprit, mais qui dans son ensemble se retient moins aisément que celle d’autres auteurs.
Ces vers qui impriment la matière cérébrale et l'âme avec, et brillent de leur singularité, j’en ai sélectionnés quelques-uns :
Dans le poème intitulé Cerises :
Aux paniers qu’on tressa durant l’hiver frileux,
La récolte croîtra, resplendissante et rouge,
Et par d’étroits sentiers, comme leurs doigts, calleux,
On sauf la crête en fleur des ronciers, rien ne bouge,
Les gens regagneront, d’ocre au pied des tucs bleus,
Le hameau familier : Le Mas, l’Age ou la Pouge.
Dans Gouhaud :
Et captifs frémissants qui battaient mon poignet,
Je revois, tout en or ou gainés d’argent vierge,
Les poissons précieux panteler sur la berge
Et happer l’air mortel d’un bec fou qui saignait.
Dans le poème intitulé Vieille auberge :
Oui, le hasard m’avait conduit, les jambes lasses
Et l’esprit obsédé d’un automnal tableau,
Feuille qui tombe ourlant un frisson bref sur l’eau,
Guérets veufs d’épis lourds désertés par les sèves,
Dans l’auberge paisible et vaste de mes rêves.
Ou encore le vers final du poème simplement intitulé Un arbre :
Et je l’aime surtout par les soirs lents et vastes
À l’heure où constellé d’éclaboussures chastes
Qui sont l’éveil léger d’astres prêts à surgir,
Il dresse sur la ville enfin lasse d’agir
Et qui, spirituelle, à rêver se hasarde,
Un front d’or où le jour, traqué d’ombre, s’attarde.
Le poète Jean Rebier (1879-1966) qui, dans un numéro de la revue Limoges - Illustré, dresse le portrait d’un Édouard Michaud alors tout juste trentenaire et déjà de solide constitution littéraire, dit de lui :
« Chaque vers d’Édouard Michaud contient une image, et il faudrait, après avoir lu un de ses sonnets, fermer les yeux et rêver un moment. Les délicats y puisent des jouissances infinies, mais le grand public qui n'aime pas à rêver et à approfondir, glisse et ne comprend pas. Et le bon poète s’en est attristé, car fils du peuple, il voudrait être surtout lu par le peuple qu’il aime et qu’il a toujours chanté. »
Quant à ses thèmes, Michaud était évidemment un régionaliste de pure essence. Tout son Limousin y est exprimé : ses villages, ses métiers, ses reliefs, ses échoppes, ses pâtres, ses ponts, ses châtaigniers…
Bref, il n'en fallait pas plus pour que le rang de plus complet des poètes du terroir limousin lui revînt de droit.
Dans sa série Anthologie des poètes limousins, publiée en épisodes dans la revue Le Limousin, son auteur, René-Georges d’Aubrun, va dans ce sens, évoquant avec beaucoup de justesse la nature d’Édouard Michaud en ces termes :
« C’est un tendre, un délicat. Nul poète n’a exprimé, avec une plus riche sensibilité, les beautés, les rudesses et les douceurs de notre vieille terre limousine. Il sent la nature profondément ; il chante, avec une joie presque panthéiste, nos labours, nos châtaigniers, nos eaux torrentueuses ou dormantes, nos molles prairies… »
Je regrette un peu pour ma part que les choses strictement agrestes y soient moins présentes que chez d’autres poètes, mais c’est là tâtillonner quelque peu.
Édouard Michaud vivait tout de même en ville, au 9 rue de Châteauroux, à Limoges, dans un petit immeuble sur le mur duquel fut après sa mort posée par la Société des Amis d’Édouard Michaud une plaque commémorative. Elle y figure encor de nos jours ; heureusement, réagirez-vous, mais je le précise car ce n’est pas toujours le cas ; par exemple, la maison natale du poète Anatole Belval-Delahaye, qui a si joliment chanté son Aisne natale, à La Ferté-Milon, a disparu avec le temps ; en tout cas, sur Google Street View, selon l'année des captures prises, tantôt elle y est, tantôt plus.
Le 9 rue de Châteauroux, domicile d’Édouard Michaud
La Société des Amis d’Édouard Michaud, présidée par son ami Jean Rebier, maintint après la mort du poète sa mémoire. Elle se chargea notamment de la réédition de son roman Margari, en version augmentée. J’ai personnellement peu goûté cette œuvre, sa « prose poétique » (je rejette cette appellation) ne m’a pas semblé refléter la qualité littéraire intrinsèque d’Édouard Michaud. Mais le roman fut très bien accueilli en son temps.
Édouard Michaud avait en tout cas touché à plusieurs genres littéraires. Dans sa vingtaine d’ans, c’est en tant que dramaturge qu’il s’exprima le plus et obtint ses premières reconnaissances hors du Limousin. Il écrivit plusieurs drames en vers dès la fin du XIXème siècle, dans la prime aube de ses 18 ans.
Ses ouvrages de poésies, parmi lesquels Fleurs éparses, Le chalel d’or, Les coqs ou encor Du soleil dans la brume, se trouvent difficilement, et c’est dans la numérisation des revues limousines du tournant du XIXème au XXème siècle que j’ai pu collecter ses poésies, et en grand nombre, en particulier dans les revues Lemouzi, La vie limousine, Le Petit Démocrate, Le Lien et, surtout, Limoges - Illustré.
Ce qui marque particulièrement est son entrée fracassante dans cette dernière ; en effet, après avoir envoyé deux poèmes à la revue — le souvenir de l’année de cette publication m’échappe — sa qualité poétique fut si instinctivement remarquée que son directeur nomma immédiatement le jeune homme au comité de rédaction. S’ensuivirent des dizaines et des dizaines de poèmes publiés au sein de la revue, et qui présentaient toujours une supériorité incontestable sur ceux des autres auteurs. Pourtant, les poètes exquis étaient nombreux au sein de la revue limousine, à commencer par Jean Rebier, ami proche de Michaud, les bien bons René Hyvert, Louis-Pascal Réjou, Jean-Baptiste Tricard, l'abbé Charles Chalmette, et d’autres.
Avant cela, il avait été, en 1897, le créateur d’une éphémère revue intitulée La Pinte.
Dans un portrait qu’il dressa de lui dans un numéro de la revue Limoges - Illustré, Hyvert le présente ainsi :
« Parmi le visage, dont les traits larges et francs révèlent la bonté du cœur, deux yeux d’éclairs changeants et vifs, comme le ciel limousin ; deux yeux, reflets d’une intelligence en travail, s’illuminant au passage des pensées. Avec cela, une voix douce et grave, chantante, qui lorsqu’elle déclame un sonnet, se fait captivante et ensorceleuse, délicieusement, si bien qu’on voudrait écouter toujours. L’âme se prend à ces tièdes accents. Michaud captive dès l’abord, par ses regards et par sa voix. »
Édouard Michaud, dans la dernière partie de sa vie.
Édouard Michaud était un ami personnel d’Eugène Le Roy, le célèbre auteur de Jacquou le Croquant, et qu’il ne rencontrera qu’une seule fois malgré une importante correspondance.
La plus ancienne mention que j’ai pu retrouver du poète est un diplôme d’honneur, reconnaissance intermédiaire entre la médaille de bronze et la simple mention, reçu lors d’un concours de poésie auquel il a participé au deuxième semestre de l’année 1892, avec un poème, dont le titre nous indique la probable modestie et la possible innocence, intitulé Gentils Oiseaux. Il était alors âgé de seize ans.
Après avoir créé avec Jean Rebier et Jean-Baptiste Sautour, l’ « Association limousine des écrivains du terroir », en 1913, il créera dans le milieu des années 1920 un groupe très inoriginalement intitulé L’École de Limoges.
Charles Argentin, le bon poète normand mort trop tôt, en fit de même avec la très inofficielle École de Fécamp, et sans doute d’autres de ces « Écoles » furent créées dans bien des régions : une appellation d’un cercle littéraire qui pouvait être rattaché à un auteur avec le secret espoir d’en faire une légende, car le poète rêve souvent de gloire même aux confins des sagesses de l’âge.
C’est donc dans le dernier décan de sa vie, celui où aucune publication poétique autre que celles au sein des revues ne parut, qu’Édouard Michaud anima ce groupe, dans lequel l’on trouvait la bonne poétesse Geneviève Michaud-Dutertre, sa fille.
Il mourut le 12 novembre 1935, là où il avait vécu, à Limoges, au 9 rue de Châteauroux.
Le site BNF Data ne lui ayant pas réservé une page, voici une liste non exhaustive de ses œuvres :
Poésie :
Fleurs d’Ogive (1893 ?)
Repentance (1893 ?)
Jonchée (1894)
Vigiles (1895)
Fleurs éparses (19??)
La Gazette de Gringoire (1909)
Le chalel d’or (1910)
Haut pays (19??)
Terre limousine (1912)
Les coqs (1914)
Le bouquet répandu (1921)
Du soleil dans la brume (1936)
Prose :
En Limousin (nouvelles, 1904)
Sous la lumière du chalel (nouvelles, 19??)
Sans culottes & barbichets (nouvelles, 1906)
Margari (roman, 1908)
Le pénitent pourpre (nouvelle, 1910)
La femme à la coupe (roman, 1919)
Le chevalier vengeur (roman, 1935)
Théâtre :
Agonie (1894)
Sur la Côte (1895)
Évangéline (1897)
La Passion (1906)
La Belle Coutelière, d’après le roman d’Eugène Le Roy (19??)
Tout va bien qui finit bien (1922)
Arthur a gagné le million (19??)
Province (1925)
La Fontaine en Limousin (1928)
Chronologie d’Édouard Michaud :
8 janvier 1876 : naissance d’Édouard Michaud.
1892 : possible première participation de l’auteur à un concours de poésie, auquel il sera mentionné pour un poème intitulé Gentils oiseaux.
1906 : nombreuses représentations dans la capitale de son drame en vers intitulé La Passion.
6 mai 1907 : décès de son ami et célèbre écrivain du terroir Eugène Le Roy, dont il sera l’un des porteurs du cercueil.
1908 : publication de son roman rustique Margari, qui deviendra l'œuvre en prose la plus estimée de l'auteur.
1911 : première et seule (?) mise en musique d’un poème d’Édouard Michaud, en l’occurrence Ode à la reine, poésie écrite en l’honneur de la Reine du Barbichet de l’époque, sur une partition du compositeur limousin Léon Roby, et chantée par deux cents enfants lors d’une représentation de la Société Harmonique.
1913 : création, avec des confrères, de l’Association limousine des écrivains du terroir.
1921 : dernier ouvrage de poésie publié du vivant de l’auteur, Le bouquet répandu.
12 novembre 1935 : décès d’Édouard Michaud.
1936 : publication posthume de son ultime ouvrage de poésie, Du soleil dans la brume.
Avril 1937 : réédition augmentée et remaniée de son roman Margari, par le Comité des Amis d’Édouard Michaud présidé par Jean Rebier.
Juin 1976 : exposition organisée à la bibliothèque municipale de Limoges pour le centenaire de la naissance de l'auteur, lors de laquelle furent exposés ses manuscrits, ses correspondances avec les écrivains de son temps, ainsi que ses aquarelles.
2023 : première publication de sa poésie sous forme audio.
Aurélien Ridon du Mont aux Aigles,
Le 20 décembre 2024.