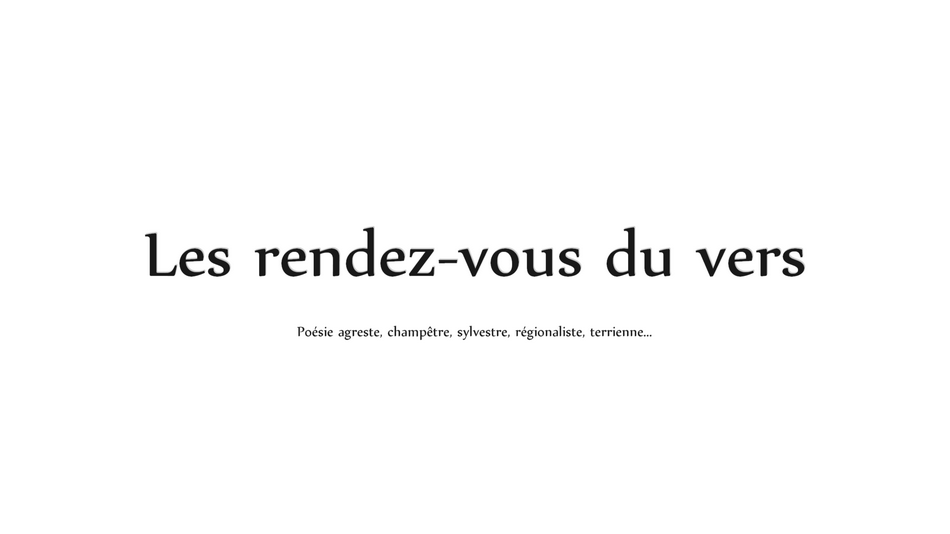Après des jours
Édouard Michaud
Après des jours dans la cité qui m’exaspère,
Après des jours où l’œil comme en exil espère
Le petit chemin creux bordé de noisetiers,
Je vous revois, côteaux parafés de sentiers,
Étangs dont le cristal dans la lumière fume.
Le vent subtil m’apporte un bruit lointain d’enclume
Avec l’encens léger d’un proche feu de bois.
Le parfum qui m’est cher déjà flotte à mes doigts,
Parfum rural et fort ou discrètement entre
L’odeur des bœufs perdus en l’herbe jusqu’au ventre,
Mélangée à votre âme, ô nos agrestes fleurs.
La nocturne rosée est déjà tout en pleurs
Sur les nets châtaigniers où le rayon vient boire.
Le loriot et la fauvette à tête noire
Sortent des hauts genêts, trille et pipeau d’argent.
Au front des tufs rocheux l’ajonc brille, émergeant
Du matelas épais des bruyères qui saignent,
Et les bouleaux s’éploient aux souffles qui les peignent.
Voici le Mas, voici la lande où j’allais voir,
Quand l’Automne en nos cœurs fait descendre le soir,
Le tragique soleil tomber comme un fruit rouge.
La source du fossé sous le gras cresson bouge,
On se sent à la fois allègre et recueilli
Et le ciel bleu qui tremble aux branches des taillis
Est si tendre qu’on rêve avec ferveur d’enfance.
Un éclair luit aux troncs tout là-bas, c’est l’Aurence
Où s’attarde le geste inlassé du pêcheur.
Et d’éprouver autour de moi tant de fraîcheur,
Tant de calme divin et de splendeur alerte,
Et de me perdre ainsi dans l’immensité verte,
Sous l’aspect que la ville absurde me donna,
Je me retrouve tel que Dieu me façonna,
Mon naturel vainqueur se risque à la fenêtre,
Je touche les contours oubliés de mon être
Et pour une heure, hélas ! — trop fugitif cadeau —
Je suis comme un poisson qu’on replonge dans l’eau.